Je vis au Maroc depuis plusieurs années, mais il y a des nouvelles qui te font serrer le cœur, même quand c'est dans une autre ville (update : c'est un mouvement qui a gagné tout le pays en 3 jours). Celles de jeunes gens pacifiques, déterminés, qui descendent dans la rue pour exiger le minimum — des hôpitaux dignes, des écoles qualifiées, la promesse d’un avenir — et qui se font répondre par des matraques, des arrestations, du silence. Le mouvement GenZ212 est l’une de ces éruptions sociales : pacifisme, revendications légitimes, et pourtant violences d’État. Je me sens concernée, parce que je crois au Maroc, à ses jeunes, à leur droit de poumonner, de rêver, de revendiquer.

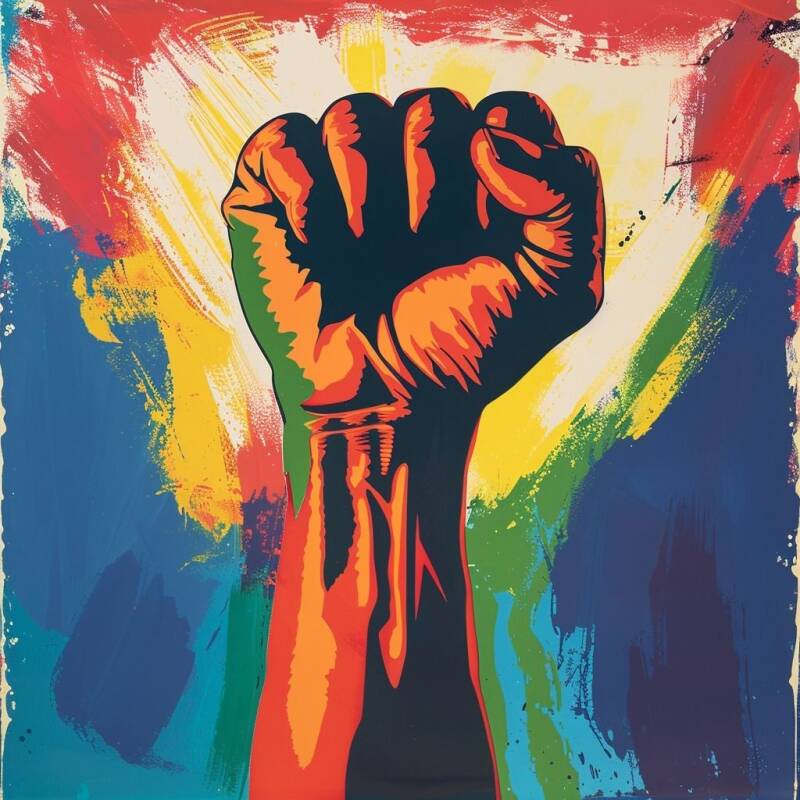
💡 L’article en bref
➕ Le mouvement GenZ212, porté par la jeunesse marocaine, a organisé des manifestations pacifistes dans tout le pays pour réclamer des hôpitaux dignes, une éducation accessible, et un avenir possible.
➕ Malgré leur pacifisme, ces jeunes ont été violemment interpellés, réprimés, réduits au silence.
➕ Les réseaux sociaux ont relayé des images bouleversantes, mais beaucoup se sont contentés de scroller, sans réagir.
➕ L’article revient sur les faits, les causes profondes, et le sens de ce combat : la dignité, la justice sociale et la voix d’une génération qui refuse d’être effacée.
➕ Se taire, c’est être complice. Ne pas dénoncer, c’est laisser la violence s’installer.
Le mercredi 1er octobre 2025 : appel à la mobilisation dans toutes les villes du Maroc devant les consulats et ambassades
Qu’est-ce que GenZ212 ? Les revendications, le contexte
Avant d’analyser, il faut poser les faits.
-
Le collectif GenZ212 (Génération Z + l’indicatif téléphonique du Maroc) est né comme une initiative de jeunesse, largement diffusée via Instagram, Discord, TikTok, X, etc.
-
Les jeunes appelaient à manifester les 27 et 28 septembre 2025 dans plusieurs villes marocaines (Rabat, Casablanca, Agadir, Tanger, Tétouan, Marrakech, Meknès, El Jadida…) pour réclamer des réformes urgentes dans les domaines de la santé publique, de l’éducation, de l’emploi et dénoncer la corruption.
-
Ils insistaient sur le fait que ces manifestations seraient pacifiques, avec des règles simples de participation, sans porte-parole officiel unique, indépendantes des partis politiques, sans haine ni violence.
-
Leur colère trouve sa source dans un mécontentement largement partagé : hôpitaux débordés, services publics insuffisants, manque de ressources, salaires faibles, chômage des jeunes très élevé, éducation qui peine à suivre.
-
Les slogans parlent : « Nous voulons des hôpitaux, pas des stades » ; « avancez le social avant la compétition sportive » ; « coupe du monde, mais quand tu vois l’état des centres de santé… » sont parmi ceux repris dans les manifestations.
Ce sont des mots simples, des demandes que l’on attendrait dans tout État qui se veut juste : dignité, santé, éducation, avenir pour tous.
Violentes interpellations : les événements
Malgré la nature pacifique annoncée, les manifestations ont été fortement réprimées. Voici ce que j’ai pu recenser :
-
Dans plusieurs villes (Rabat, Casablanca, Tétouan, Marrakech, Agadir…), des jeunes ont été interpellés. Parfois des dizaines, selon les témoignages ou les ONG impliquées.
-
Des forces de l’ordre aux méthodes musclées : dispersion de rassemblements, usage de la force, bousculades, interventions rapides, parfois sans que les manifestants aient eu le temps de comprendre ce qu’il se passait ou de se disperser calmement.
-
Arrestations même de personnes âgées ou de passants, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ; parfois d’étudiants simplement en train de marcher, de scander un slogan.
-
Dans certains cas, les interpellés sont relâchés après vérification, audition ou de leur identité, mais l’arrestation elle-même, et la violence qui l’accompagne, laisse des traces — physiques, psychologiques, sociales.
-
Des ONG dénoncent l’usage excessif de la force, la répression de la liberté d’expression et de réunion pacifique, et réclament des enquêtes impartiales.
Pourquoi le silence est-il si répandu ?
C’est là que je me sens tiraillée : je reçois ici des messages, des vidéos, des témoignages, mais partout ce silence pesant. Quelques raisons :
-
La peur : pour beaucoup, manifester est risqué, être vu, être identifié, subir les représailles.
-
Distance géographique ou sociale : ceux qui ne vivent pas dans les grandes villes ou n’ont pas accès aux réseaux, n’entendent pas, ne voient pas.
-
L’individualisme numérique : beaucoup regardent, likent, scrollent, mais peu s’engagent. On partage une vidéo, on passe à autre chose.
-
La désillusion : certains pensent que rien ne changera, que parler c’est inutile, que tout est verrouillé.
-
La répression préventive : quand des autorités interdisent les rassemblements, dispersent d’avance, ou interpellant dès qu’un groupe se forme, l’espace de contestation se réduit. L’effet peut être de décourager la participation.
Mais le silence — c’est choisir de ne pas être complice, c’est rester otage d’un statu quo violent et injuste.
Analyser : la violence comme réponse à la détresse
Je ne crois pas que la violence soit justifiable, mais ce que je vois, c’est que le calme, le pacifisme, ne suffisent pas toujours à être écouté. Je veux rappeler deux idées, parce qu’elles me semblent essentielles.
-
L’histoire : quand personne ne résiste, rien ne change. Si pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés — ou les résistants — avaient choisi le silence, ou l’inaction, Hitler ne serait peut-être pas arrêté. Parfois, réclamer le droit fondamental devient devoir citoyen.
-
Les réseaux sociaux comme armes invisibles. En 2025, Instagram, TikTok, Discord, X ne sont pas juste des plateformes : ce sont des amplificateurs de douleur, de colère, d’espoir. Quand une vidéo montre une arrestation arbitraire, quand un témoignage parle d’un hôpital débordé, cela retentit au-delà des frontières de la ville, de la région, du pays. Cela peut toucher la diaspora, la communauté internationale.
Mais la violence institutionnelle — celle exercée par l’État, les forces de l’ordre — laisse des cicatrices invisibles : peur, méfiance, fracture sociale. Et elle érode la confiance entre les citoyens et ceux qui sont censés les protéger.
Exemples poignants
Je voudrais évoquer quelques faits qui m’ont particulièrement marquée, pour que ce ne soit pas abstrait :
-
À Rabat, des jeunes arrêtés alors qu’ils essayaient simplement de scander des slogans devant le Parlement ou de parler aux médias. Des plain-challenges. Des personnes âgées, des étudiantes arrêtées pour être dans la rue.
-
À Casablanca, des scènes de dispersion, bousculades, des manifestants qui tentent de se rassembler place Derb Sultan, puis qui subissent l’intervention policière, des arrestations dans des rues adjacentes.
-
Un témoignage d’un ingénieur de 27 ans à Casablanca : « Je ne veux pas seulement des réformes dans les domaines de la santé et de l’éducation, je veux une réforme de l’ensemble du système. Je veux de meilleurs salaires, de meilleurs emplois, des prix bas et une vie meilleure ».
Ce qu’il faut entendre : au-delà des slogans, une souffrance réelle
Je veux que vous ressentiez ce que je vois, même d’ici :
-
Hôpitaux qui saignent, littéralement : manque de matériel, de personnel, patients laissés dans des corps souffrants, familles qui attendent, espèrent, souvent en vain.
-
Éducation à la traîne : classes surchargées, surtout en zones rurales ; enseignants sans ressources, infrastructures dégradées, accès limité. Cela crée une fracture — la jeunesse d’aujourd’hui ne se reconnait pas dans le rêve marocain qu’on lui promet.
-
L’avenir incertain : avec un taux de chômage des jeunes élevé, des diplômés qui ne trouvent pas d’emploi, les rêves quittent le pays, ou s’éteignent dans le silence.
-
La dignité : ce droit fondamental, auquel chaque être humain aspire — soigner ses enfants, apprendre, avoir une voix — est bafoué quand on empêche les gens de s’exprimer pacifiquement, quand on les arrête pour avoir chanté, crié, dénoncé.
La morale de l’histoire : pourquoi la non-violence importe, mais le silence est complice
Je ne prône pas la violence. Je crois que les changements durables viennent quand la voix est claire, quand la revendication est juste, quand l’action pacifique se conjugue avec une forte conscience collective.
Mais :
-
Refuser de dénoncer les violences, c’est laisser la porte ouverte à leur répétition.
-
Le silence ne protège pas ; il rend complice.
-
Être passif, c’est accepter que des jeunes courageux soient isolés, seuls dans la rue, exposés à la répression.
Si ceux qui ne peuvent pas marcher dans la rue pour des raisons personnelles — peur, santé, distance, contraintes — ils peuvent au moins être solidaires : partager, relayer, questionner, demander des comptes. Comme pendant le séisme de septembre, où malgré la gravité, des communautés ont bougé, partagé, aidé, témoigné.
Comparaisons mondiales : leçon d’ailleurs
-
Le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1960 : sit-ins pacifiques, marches, refus de la violence, pourtant confrontés à une brutalité policière démesurée. Et pourtant, ces résistances ont changé des lois, des mentalités.
-
Le Printemps arabe : des révoltes pacifiques au départ, parfois dégénérées sous l’effet de la répression, mais souvent force de transformation, même si imparfaite.
-
Les manifestations en France autour des retraites, ou les Gilets jaunes : même si le contexte diffère, l’idée reste : quand on empêche la parole, quand les revendications sociales sont ignorées, les tensions montent.
Ces exemples montrent que la justice sociale, l’écoute, la dignité ne sont pas des luxes — ce sont des piliers sur lesquels se construit une société juste.
Que pourraient faire les autorités ? Et que pouvons nous faire, nous
Je me permets, en tant qu’observatrice mais aussi en tant que citoyenne morale, de proposer des pistes. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de dénoncer, mais aussi de penser.
Ce que les autorités pourraient faire :
-
Reconnaître officiellement les manifestations pacifiques : autoriser les rassemblements quand les organisateurs respectent les règles, même si ce n'est pas parfait.
-
Limiter l’usage de la force : formation, encadrement, responsabilité claire en cas d’abus.
-
Ouvrir un dialogue réel : écouter les revendications, répondre avec des mesures concrètes et visibles. Ne pas juste promettre, agir.
-
Transparence et justice : enquêter sur les interpellations violentes, publier les résultats, sanctionner si nécessaire.
-
Investir prioritairement dans la santé, l’éducation, l’emploi : budgets, ressources humaines, infrastructures. Montrer dans les actes que la priorité est aux besoins fondamentaux des gens.
Ce que chacun de nous peut faire :
-
Ne pas rester passif : partager les témoignages, les vidéos, les reportages.
-
Encourager le dialogue dans son entourage, discuter, s’informer.
-
Soutenir les associations, les ONG, les militants pour les droits humains.
-
Demander des comptes aux responsables politiques, suivre les promesses, exiger des actions concrètes.
-
Être solidaire, pas seulement dans la rue, mais dans les gestes quotidiens : écouter, ne pas oublier.
Mon point de vue : un appel à ne pas oublier, à ne pas se taire
En tant qu’expatriée, je vis l’ambivalence : j’ai parfois l’impression de n’être qu’une voix parmi d’autres, peut-être plus libre de parler mais aussi moins entendue. Pourtant, je crois profondément que chaque mot compte, chaque témoignage, chaque reflet de vérité pèse.
Je refuse l’idée que la violence — qu’elle soit institutionnelle, policière — soit la réponse aux mots, aux slogans, aux rêves. Et je refuse aussi le silence. Nous ne pouvons pas tolérer que des jeunes soient arrêtés parce qu’ils veulent juste des hôpitaux, des écoles, un avenir. La dignité n’est pas une faveur, c’est un droit. Pour moi, ce pays le Maroc m'a accueilli et a tout ceux qui me demandent, ne restez pas silencieux, participez : ✊ « Ils demandent des hôpitaux, on leur répond par des menottes. Le silence, c’est la complicité.
🌴 Touristes, regardez au-delà de la carte postale
Je vis au Maroc depuis assez longtemps pour le dire : ce pays ne se résume pas à ses palmiers photogéniques, ses riads aux carreaux colorés, ou ses couchers de soleil instagrammables.
Derrière les souks animés, les piscines d’hôtels, les festivals glamour, il y a un peuple fier, chaleureux, mais épuisé par un système qui souvent oublie ses priorités.
Alors oui, le Maroc séduit, mais il saigne aussi.
Et aimer le Maroc, c’est aussi voir ce qui fait mal :
-
des hôpitaux surchargés, où des patients attendent des heures sans soins,
-
des écoles rurales délabrées, où les enfants manquent de livres,
-
des jeunes diplômés désespérés, sans travail, ni perspectives.
Quand on voyage ici, on doit le faire avec les yeux ouverts.
Soutenir les artisans locaux, écouter les habitants, comprendre les luttes sociales, et relayer leurs voix, c’est aussi une façon d’aimer vraiment le Maroc.
Parce qu’un pays n’est pas seulement une destination, c’est une humanité.
Et aujourd’hui, cette humanité réclame juste un peu de dignité.
Violentes interpellations lors de manifestations pacifistes au Maroc — ce n’est pas seulement un fait de plus dans l’actualité. C’est un signal d’alarme.
GenZ212 ne réclame pas la lune. Juste ce qui devrait être normal : santé, éducation, opportunités, justice. Le problème survient non quand on réclame, mais quand on refuse d’entendre, qu’on répond par la peur plutôt que par le dialogue.
Je crois au Maroc. Je crois dans sa jeunesse. Et je crois que ce moment peut être un point de bascule : soit la continuation de la peur, du mutisme et de l’injustice, soit l’éveil d’une société qui écoute, qui respecte, qui répare.
Si vous lisez ceci et que vous êtes silencieux, vous avez un choix : continuer à scroller ou lever la voix. Ne permettons pas que le silence soit la complicité. Et ne permettons pas que les blessures — visibles ou cachées — soient vaincues par l’oubli.

FAQ : ce qu’il faut savoir
🕊️ “Ne laissons pas leurs cris se perdre dans le bruit du monde. Soyons la voix de ceux qu’on veut faire taire.”
Ajouter un commentaire
Commentaires